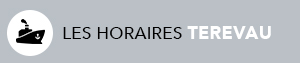Dans la société insulaire ancienne, les familles avaient l’habitude de i[fa’a’amu]i mutuellement leurs enfants. Crédit photo : Erwin Christian, 1971
Notre Académie locale a trop souvent opté de prononcer à la mode de Tahitiens qui n’existent plus des concepts occidentaux, sans chercher à les rendre intelligibles. Par exemple, mōrare pour la morale et, par extension d’usage : le moral et le bilan moral ! Pourtant, des mots équivalents existent en tahitien pour ces nuances. De rajouter un tārava sur la voyelle o n’en fait pas un mot tahitien. Et l’on s’étonne que la langue tahitienne soit en voie d’extinction !
Pour cette institution fa’a’amu, c’est adopter !
Or,
Fa’a’amu signifie nourrir. Cela sous-entend que l’on ouvre ses bras pour accueillir sans retenir. L’enfant nourri peut aller et venir à sa guise. Il n’est pas captif. Les bras ne se referment pas.
Adopter c’est choisir pour soi, faire sien, prendre. Les bras se referment sur l’enfant.
Ces mots ne sont pas équivalents. Ils expriment des modes différents de relations à l’enfant et en société. Sans instaurer une échelle de valeurs entre ces sociétés, reconnaître la différence et les nuances est essentiel à l’existence de liens apaisés entre les personnes issues de cultures différentes. Quand de part et d’autre l’on cherche à établir et consolider des liens chaleureux en allant au-delà des paroles doctes parfois toc, l’adoption d’un enfant est une merveilleuse aventure. Par contre, utilliser le malentendu langagier pour s’approprier un enfant vient illustrer la parole d’Albert Camus pour qui :
“Mal nommer un objet c’est rajouter au malheur du monde.”
Dans la société insulaire ancienne, les familles – y compris de pouvoir – avaient l’habitude de fa’a’amu mutuellement leurs enfants, qui allaient et venaient sans entraves d’une famille à l’autre. Ainsi, Ariitaimai des Teva et Pomare IV se considéraient sœurs, car leurs familles les avaient fa’a’amu réciproquement. Elles marièrent leurs enfants (Pomare V et Marau Salmon), dont les liens matrimoniaux furent très éphémères, contrairement à ceux du fa’a’amu.
Au XIXe siècle, Ma’uahiti, ari’i de Pare, dont le fils fut enlevé par l’une des nombreuses maladies épidémiques introduites, prit Tū comme fils fa’a’amu afin de lui léguer son titre et son marae. Tū devint plus tard : Pomare.
Fa’a’amu, c’était et c’est encore aussi pour un couple ou une personne sans enfants par stérilité ou accident de la vie de se choisir un enfant, une famille, afin que perdure un nom et un patrimoine matériel et immatériel. Car certains noms étaient aussi des titres nobiliaires. Leur usage anarchique actuel signe une perte de références culturelles.
Fa’a’amu est donc la concrétisation et transformation consolidation d’un lien amical en lien filial, voire un renforcement du lien filial.
Encore aujourd’hui, il est coutumier de voir une famille fa’a’amu un ou des neveux et nièces, voire des enfants de feti’i plus ou moins proches durant des périodes plus ou moins longues. Et cela, jusqu’au jour où la famille biologique les reprenne ou que l’enfant fa’a’amu, devenu adulte, vole de ses propres ailes.
Tel que l’ont vécu et le vivent nombre de personnes, le fa’a’amu équivaut parfois au parrainage ou marrainage, où les parrains et marraines sont intégrés au cercle des proches et fēti’i plus ou moins éloignés, mais membres d’une même famille.
Pour des raisons diverses, des grands-parents exigent parfois l’aîné, le cadet ou la cadette, voire le benjamin soit de leur aîné, soit de tous leurs enfants, à fa’a’amu. Cela peut se faire de manière complice, comme autoritaire. La motivation varie entre aimer s’occuper de petits-enfants et/ou se préparer un ou des bâtons de vieillesse. Ce qui n’est pas sans poser des problèmes à l’adolescence, où les grands-parents sont dépassés dans une société aux exigences et contraintes nouvelles. Et, quand les vieux meurent, si l’enfant encore jeune doit rentrer chez ses parents, c’est souvent pour son malheur. Il est pris en grippe et devient le souffre-douleur. Et cela, que les grands-parents lui aient fait ou non des legs spéciaux d’une terre ou de la maison familiale. Mais si les grands-parents n’ont pas pris des dispositions légales, l’enfant peut se retrouver totalement spolié, en plus de subir des sévices corporels et psychiques majeurs.
Cette violente animosité envers son enfant fa’a’amu-adopté par ses propres parents m’a toujours intriguée. Est-ce le fait de voir et vivre l’arbre généalogique comme chamboulé ? Je me permets une digression : “Mon fils devient donc mon frère ? S’il devient mon frère c’est que quelque chose de pas correct s’est passé entre mes parents et moi, quelque chose d’inacceptable... Même si ce n’est que sur le plan symbolique, c’est vécu comme une violence intime parfois.”
Ce qui amène à poser le cas de l’inceste quand il devient réalité tangible. Il bouleverse totalement l’ordre social et familial. L’enfant né d’inceste semble être celui qui est donné en adoption la plus lointaine le plus facilement et le plus irrémédiablement.
Dans nos îles, le fa’a’amu-adopté n’a pas concerné que la population indigène.
Nous savons que dans la Chine ancienne, les filles pouvaient être éliminées à la naissance. C’était culturellement admis. En venant à Tahiti, l’infanticide des bébés filles continua à être pratiqué et fut relayé par l’abandon à une famille tahitienne qui les prenait en fa’a’amu ou les adoptait à la française, en leur donnant leur nom.
Le contrôle des naissances et la pilule, voire l’IVG, firent cesser ces solutions extrêmes.
Souvenons-nous, les premiers Chinois dans les Établissements français de l’Océanie n’avaient qu’un numéro pour se distinguer de leurs congénères. Ceux qui restaient désiraient obtenir la nationalité française, qui ne leur était pas accordée. Aussi, certains demandèrent à des familles tahitiennes de reconnaître et/ou d’adopter légalement leurs enfants afin de leur faire obtenir la nationalité française. Cela, tout en gardant leurs enfants avec eux et en entretenant des liens avec au moins la personne adoptante. Car au regard de la famille de l’adoptant, ces adoptés venaient réduire leur quote-part successorale en biens fonciers. C’est ainsi que dans des affaires de terres, l’on trouve des noms chinois pas toujours bienvenus. Cette pratique a cessé quand de Gaulle eut besoin des voix des Chinois installés à Tahiti pour avoir la majorité au référendum pour ou contre l’Indépendance défendue par Pouvana’a a O’opa. Il leur offrit la nationalité française, remporta l’élection et mena à bien sa politique de dissuasion nucléaire.
Quand des Européens en mal d’enfants viennent en chercher ici, les conséquences sont parfois heureuses et parfois non. Autant de familles, autant de situations, de malentendus, de connivences, avec leurs lots de joies, drames, motifs de réjouissances et regrets.
Car qui sait si, d’être restés auprès de leurs parents biologiques leur aurait assuré un bon épanouissement ? Personne ne peut le garantir. D’autant que si l’enfant a été donné, c’est que les parents l’ont décidé… quitte à le regretter plus tard. À moins d’être sous emprise, personne ne les contraint. Et la loi permet à la mère qui donne de reprendre son enfant si elle le souhaite vraiment. J’ai connu le cas d’une famille qui, après avoir donné une de ses filles à une famille gardoise, en fabriqua spécialement une autre deux ans plus tard, pour que la précédente ne “s’ennuie pas toute seule là-bas”. Des liens solides existent entre les donataires et les donateurs.
Pour avoir travaillé en ethnopsychiatrie et tissé des relations avec des pédopsychiatres ici et en Métropole, il m’est arrivé d’être interpellée pour qu’une réflexion soit menée sur ces enfants polynésiens adoptés, vivant en Métropole et qui ne vont pas bien du tout. Des praticiens sont désemparés par certaines situations où l’enfant est tellement plus grand et plus fort que ses deux parents réunis, dans un milieu où ils font figure de bêtes curieuses aux prises aux expressions fielleuses toutes faites de malingres. Et quand ils ont la possibilité de venir dans nos îles, si leur apparence ne les distingue plus des autres, par contre, leur éducation et leur univers mental en font des étrangers totaux et non des “étrangers familiers”.
Ne faisant plus partie de ce réseau, je n’ai pas pu y donner suite. Toutefois, puisqu’une réflexion existe en droit sur le fa’a’amu et l’adoption, il serait intéressant de mener une étude sur le devenir de ces enfants mis hors circuit familial biologique, géographique, historique et culturel pour être inclus dans un autre cercle familial. Les constats offriront sans doute toute une palette de situations conviant à une approche humble et vigilante. Nul doute que des lignes de force se dessineront toutefois.
Pour cette institution fa’a’amu, c’est adopter !
Or,
Fa’a’amu signifie nourrir. Cela sous-entend que l’on ouvre ses bras pour accueillir sans retenir. L’enfant nourri peut aller et venir à sa guise. Il n’est pas captif. Les bras ne se referment pas.
Adopter c’est choisir pour soi, faire sien, prendre. Les bras se referment sur l’enfant.
Ces mots ne sont pas équivalents. Ils expriment des modes différents de relations à l’enfant et en société. Sans instaurer une échelle de valeurs entre ces sociétés, reconnaître la différence et les nuances est essentiel à l’existence de liens apaisés entre les personnes issues de cultures différentes. Quand de part et d’autre l’on cherche à établir et consolider des liens chaleureux en allant au-delà des paroles doctes parfois toc, l’adoption d’un enfant est une merveilleuse aventure. Par contre, utilliser le malentendu langagier pour s’approprier un enfant vient illustrer la parole d’Albert Camus pour qui :
“Mal nommer un objet c’est rajouter au malheur du monde.”
Dans la société insulaire ancienne, les familles – y compris de pouvoir – avaient l’habitude de fa’a’amu mutuellement leurs enfants, qui allaient et venaient sans entraves d’une famille à l’autre. Ainsi, Ariitaimai des Teva et Pomare IV se considéraient sœurs, car leurs familles les avaient fa’a’amu réciproquement. Elles marièrent leurs enfants (Pomare V et Marau Salmon), dont les liens matrimoniaux furent très éphémères, contrairement à ceux du fa’a’amu.
Au XIXe siècle, Ma’uahiti, ari’i de Pare, dont le fils fut enlevé par l’une des nombreuses maladies épidémiques introduites, prit Tū comme fils fa’a’amu afin de lui léguer son titre et son marae. Tū devint plus tard : Pomare.
Fa’a’amu, c’était et c’est encore aussi pour un couple ou une personne sans enfants par stérilité ou accident de la vie de se choisir un enfant, une famille, afin que perdure un nom et un patrimoine matériel et immatériel. Car certains noms étaient aussi des titres nobiliaires. Leur usage anarchique actuel signe une perte de références culturelles.
Fa’a’amu est donc la concrétisation et transformation consolidation d’un lien amical en lien filial, voire un renforcement du lien filial.
Encore aujourd’hui, il est coutumier de voir une famille fa’a’amu un ou des neveux et nièces, voire des enfants de feti’i plus ou moins proches durant des périodes plus ou moins longues. Et cela, jusqu’au jour où la famille biologique les reprenne ou que l’enfant fa’a’amu, devenu adulte, vole de ses propres ailes.
Tel que l’ont vécu et le vivent nombre de personnes, le fa’a’amu équivaut parfois au parrainage ou marrainage, où les parrains et marraines sont intégrés au cercle des proches et fēti’i plus ou moins éloignés, mais membres d’une même famille.
Pour des raisons diverses, des grands-parents exigent parfois l’aîné, le cadet ou la cadette, voire le benjamin soit de leur aîné, soit de tous leurs enfants, à fa’a’amu. Cela peut se faire de manière complice, comme autoritaire. La motivation varie entre aimer s’occuper de petits-enfants et/ou se préparer un ou des bâtons de vieillesse. Ce qui n’est pas sans poser des problèmes à l’adolescence, où les grands-parents sont dépassés dans une société aux exigences et contraintes nouvelles. Et, quand les vieux meurent, si l’enfant encore jeune doit rentrer chez ses parents, c’est souvent pour son malheur. Il est pris en grippe et devient le souffre-douleur. Et cela, que les grands-parents lui aient fait ou non des legs spéciaux d’une terre ou de la maison familiale. Mais si les grands-parents n’ont pas pris des dispositions légales, l’enfant peut se retrouver totalement spolié, en plus de subir des sévices corporels et psychiques majeurs.
Cette violente animosité envers son enfant fa’a’amu-adopté par ses propres parents m’a toujours intriguée. Est-ce le fait de voir et vivre l’arbre généalogique comme chamboulé ? Je me permets une digression : “Mon fils devient donc mon frère ? S’il devient mon frère c’est que quelque chose de pas correct s’est passé entre mes parents et moi, quelque chose d’inacceptable... Même si ce n’est que sur le plan symbolique, c’est vécu comme une violence intime parfois.”
Ce qui amène à poser le cas de l’inceste quand il devient réalité tangible. Il bouleverse totalement l’ordre social et familial. L’enfant né d’inceste semble être celui qui est donné en adoption la plus lointaine le plus facilement et le plus irrémédiablement.
Dans nos îles, le fa’a’amu-adopté n’a pas concerné que la population indigène.
Nous savons que dans la Chine ancienne, les filles pouvaient être éliminées à la naissance. C’était culturellement admis. En venant à Tahiti, l’infanticide des bébés filles continua à être pratiqué et fut relayé par l’abandon à une famille tahitienne qui les prenait en fa’a’amu ou les adoptait à la française, en leur donnant leur nom.
Le contrôle des naissances et la pilule, voire l’IVG, firent cesser ces solutions extrêmes.
Souvenons-nous, les premiers Chinois dans les Établissements français de l’Océanie n’avaient qu’un numéro pour se distinguer de leurs congénères. Ceux qui restaient désiraient obtenir la nationalité française, qui ne leur était pas accordée. Aussi, certains demandèrent à des familles tahitiennes de reconnaître et/ou d’adopter légalement leurs enfants afin de leur faire obtenir la nationalité française. Cela, tout en gardant leurs enfants avec eux et en entretenant des liens avec au moins la personne adoptante. Car au regard de la famille de l’adoptant, ces adoptés venaient réduire leur quote-part successorale en biens fonciers. C’est ainsi que dans des affaires de terres, l’on trouve des noms chinois pas toujours bienvenus. Cette pratique a cessé quand de Gaulle eut besoin des voix des Chinois installés à Tahiti pour avoir la majorité au référendum pour ou contre l’Indépendance défendue par Pouvana’a a O’opa. Il leur offrit la nationalité française, remporta l’élection et mena à bien sa politique de dissuasion nucléaire.
Quand des Européens en mal d’enfants viennent en chercher ici, les conséquences sont parfois heureuses et parfois non. Autant de familles, autant de situations, de malentendus, de connivences, avec leurs lots de joies, drames, motifs de réjouissances et regrets.
Car qui sait si, d’être restés auprès de leurs parents biologiques leur aurait assuré un bon épanouissement ? Personne ne peut le garantir. D’autant que si l’enfant a été donné, c’est que les parents l’ont décidé… quitte à le regretter plus tard. À moins d’être sous emprise, personne ne les contraint. Et la loi permet à la mère qui donne de reprendre son enfant si elle le souhaite vraiment. J’ai connu le cas d’une famille qui, après avoir donné une de ses filles à une famille gardoise, en fabriqua spécialement une autre deux ans plus tard, pour que la précédente ne “s’ennuie pas toute seule là-bas”. Des liens solides existent entre les donataires et les donateurs.
Pour avoir travaillé en ethnopsychiatrie et tissé des relations avec des pédopsychiatres ici et en Métropole, il m’est arrivé d’être interpellée pour qu’une réflexion soit menée sur ces enfants polynésiens adoptés, vivant en Métropole et qui ne vont pas bien du tout. Des praticiens sont désemparés par certaines situations où l’enfant est tellement plus grand et plus fort que ses deux parents réunis, dans un milieu où ils font figure de bêtes curieuses aux prises aux expressions fielleuses toutes faites de malingres. Et quand ils ont la possibilité de venir dans nos îles, si leur apparence ne les distingue plus des autres, par contre, leur éducation et leur univers mental en font des étrangers totaux et non des “étrangers familiers”.
Ne faisant plus partie de ce réseau, je n’ai pas pu y donner suite. Toutefois, puisqu’une réflexion existe en droit sur le fa’a’amu et l’adoption, il serait intéressant de mener une étude sur le devenir de ces enfants mis hors circuit familial biologique, géographique, historique et culturel pour être inclus dans un autre cercle familial. Les constats offriront sans doute toute une palette de situations conviant à une approche humble et vigilante. Nul doute que des lignes de force se dessineront toutefois.

 Edito
Edito