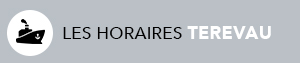i[Cession du district de Matavai à Tahiti au Capitaine James Wilson pour l’usage des missionnaires.]i (Gravure de 1801. Édition réalisée au profit de la London Missionary Society) - Crédit photo : DR
Il est saisissant de constater à quel point la fiction, le mythe, ha’avare, kareho, fake, truffe les récits et discours sur Tahiti et ses îles. Cela est gigantesquement évident dès il s’agit de religion... et de politique. Mais pas que... On reconnaît d’ailleurs les deux principaux registres au ton généralement docte et solennel de leurs représentants, adeptes et militants. Comme si l’emphase et le trémolo étaient garants d’authenticité authentique et de justesse juste. Hum !
Le “pieux” mensonge au nom de la “Vérité vraie” et les lubies d’ignorants inventant des entités menaçantes exterminatrices sont dites “fadaises” dans le midi de la France et ici : parau ha’avare, parau punu.
Les déballeurs d’énormités sont présents aussi bien dans le groupe des non-originaires du fenua que dans celui des originaires plus ou moins métissés, se revendiquant mā’ohi depuis les années 1980. Parfois, c’est comme s’il existait un concours. À friser le ridicule ! Ridicule qui ne tue pas les corps, mais participe à geler, tuer la pensée. Or geler, tuer la pensée, c’est amener le plus grand nombre à laisser à autrui le soin de penser et décider à sa place. Œuvrer à empêcher le développement de la pensée critique participe à générer les dérives de comportement d’une partie de notre jeunesse. Les adeptes de la délégation de leur pensée entre les mains d’autrui sont facilement sous emprise et excellent à débiter des phrases toutes faites. Mobiliser à nouveau leurs impertinentes cellules grises endormies, c’est faire acte de culture et d’amitié.
Les originaires et non-originaires du fenua se racontent des films plutôt différents dans un même paysage. C’est normal car les uns et les autres n’ont pas vécu l’Histoire de la même façon. Ils n’étaient pas et ne sont toujours pas forcément du même côté des fronts de batailles. Il y eut des vainqueurs et des vaincus. La ligne de démarcation persiste invisible dans des combats d’apparence pacifique pour la maîtrise des rivages et de l’espace. Autant être lucide. Par exemple, les SDF ne se recrutent que dans une seule ethnie. Signe non pas d’infériorité congénitale, mais d’une mise à l’écart systémique qui exige une réflexion suivie d’actes salutaires.
Attardons-nous sur ce qu’une majorité des originaires du fenua présente comme son ossature, son identité profonde. Attardons-nous sur la religion, dont beaucoup se drapent. Sur les faits de l’Histoire, sans pudeur aucune, ça ment comme pas possible.
Ainsi le 5 mars 1797 est célébré comme la date de l’arrivée de l’Évangile en ce qui est aujourd’hui la Polynésie française. Or, c’est faux.
Le premier office chrétien célébré dans nos îles le fut en juillet 1595. Mendana assista à cette messe avec son épouse et nomma ces îles : “Marquises”.
Le deuxième office le fut à Tahiti en 1772 à la Presqu’île, par des Espagnols qui y restèrent évangéliser jusqu’en 1776. En vain. Les habitants étaient très heureux de leur mode de vie. Ils n’éprouvaient nul besoin d’en changer.
Le Duff affrété par la London Missionary Society arriva le 4 mars 1797 dans l’indifférence générale. Et non le 5 mars dans la liesse comme d’aucuns tentent de le faire croire. Ce n’est que vingt ans plus tard, dans les années 1817-18, que les Tahitiens en deuil permanent depuis l’introduction de maladies épidémiques par Wallis en 1767 et renouvelées par tous les navires suivants, commencèrent à s’intéresser aux discours des hommes pâles. L’attrait devint impérieux quand ils commencèrent à avoir faim. Car John Orsmond en rajouta à la détresse en faisant abattre nombre d’arbres à pain. Il provoqua et organisa la faim en créant la pénurie alimentaire d’aliments traditionnels. C’était le seul moyen qu’il avait trouvé pour attirer les Tahitiens et leur fournir l’Évangile, en même temps que la farine importée. (Tahiti aux temps anciens, Ed. 2000 p. 12)
Étrange est aussi le silence sur la pudibonderie qui prévalut plus d’un siècle. En témoignent les photographies anciennes où les vêtements partent du cou des femmes jusqu’à leurs chevilles et cachent leurs bras. Où les chemises à manches longues, vestes et pantalons engoncent les hommes. “Cachez ces peaux que l’on ne saurait voir !” fut asséné à ce peuple qui ne se dévêtait pourtant qu’en allant à la mer ou la rivière. Les femmes surtout durent se baigner habillées et garder leurs vêtements mouillés, se rendant ainsi vulnérables aux refroidissement si dangereux au temps de la propagation durant deux cents ans du bacille de la tuberculose.
Les danses furent interdites sous peine de sanctions sévères. Le Protectorat français leva les interdits religieux pesant sur les danses. Réjouis, mais encore honteux de leurs corps religieusement maudits, les insulaires superposèrent sur leurs peaux trop belles pour être exposées aux regards, les vêtements du dimanche et, par dessus, des souvenirs des costumes de danses ancestrales. Ils devaient drôlement souffrir sous ces accoutrements. Et il en fallut des décennies avant qu’ils ne s’en allègent !
Ce 5 mars 2021, des jeunes gens presque nus dansèrent gracieusement un 5 mars 1797 qui n’a jamais eu lieu. Si leurs ancêtres avaient dansé ainsi, les missionnaires se seraient cachés ou, se voilant la face tout en zieutant entre leurs doigts, ils auraient brandi leurs Bibles en les traitants d’enfants de Satan, Tamari’i ’a Tatane. C’est d’ailleurs ainsi que ma grand-mère me grondait quand je dansais au rythme des pahu et tō’ere lointains.
Pourquoi les responsables politico-religieux continuent-ils de mentir ? La mauvaise date est même devenue jour férié ! C’est du grand n’importe quoi !
Une élue indépendantiste réclame le retour du contenu des archives polynésiennes conservées en Europe afin de se réapproprier son Histoire. C’est une excellente idée. Mais quand on voit le traitement infligé aux faits avérés, on se demande pourquoi ! Est-ce pour mieux les dissimuler comme des “secrets-défense” ? Notons que dans le domaine dit de la Culture, on ne met presque jamais des gens compétents. Il n’y a jamais d’exigence de formation aboutie correspondant aux missions confiées. Au service des archives, je n’ai jamais connu d’archiviste dûment formé. Oh des gens y travaillent, certes. Et avec application. Mais sans la formation adéquate. Des personnels s’en plaignent. C’est comme si, dans ce domaine, il semble y avoir un consensus pour se contenter de l’à-peu-près. Affichant parfois une bizarre fierté d’y avoir placé des personnels formés à autre chose. Il est vrai que nos gouvernants sont rarement de vrais experts en quelque chose. Beaucoup ont commencé un cursus universitaire, mais se sont arrêté en cours de route. Ce sont des “presque” experts qui se cooptent mutuellement. Comme si l’on redoutait de nommer des personnels sérieusement formés. Je me demande ce qu’en diront les générations futures quand viendra leur temps. Surtout si elles sont plus exigeantes envers elles-mêmes.
Par contre, là où il y a du personnel nationalement et donc internationalement reconnu compétent, j’ai vu des audits se succéder de manière ahurissante. Pour en définitive mettre à leur tête des incompétents notoires. Comme pour brimer la vraie compétence et la punir.
Quant à l’Académie, nul n’a jamais éprouvé la nécessité d’y faire un audit sérieux. Pourtant, la lecture du dico en signale l’urgence gravissime.
À croire que l’incompétence et le contre-emploi rassurent nos élites politico-religieuses.
Certains de nos non-originaires du fenua ont eux aussi des comportements singuliers. J’en connais qui, présents depuis près de cinquante ans, s’estiment être toujours des “invités” et, par exemple, n’achètent pas de terre pour ne pas participer à la flambée du prix du foncier. Une de mes amies m’a demandé de chercher un mot pour la définir, elle qui est arrivée bébé : “Aux Antilles, il y a les Békés. Je suis Popa’ā. Mais je n’ai rien à voir avec la Popa’ā qui débarque et se croit tout permis. Il n’y a pas de mot pour dire qui je suis.” Elle en était profondément chagrinée.
D’autres se revendiquent Tahitiens avant même de poser le pied à Faa’a ou d’ancrer leur bateau dans le lagon. Leur rappeler même gentiment qu’ils ne le sont pas est vécu comme une agression raciste. Bizarre ! Déconcertant. Car jamais en Afrique noire ou du Nord, un Métropolitain ne s’est revendiqué Sénégalais ou Algérien. En Indochine, nul ne s’est revendiqué Nha qué. En Nouvelle-Calédonie, nul ne se prétend Kanak s’il ne l’est pas pas et à Wallis-et-Futuna idem. Mais ici ! C’est spécial.
Ainsi, sommes-nous dans notre diversité chatoyante, parfois parfumée et parfois malodorante.
Puissions-nous privilégier les doux parfums. Seule la connaissance approfondie de nos passés respectifs nous aidera à vivre plus sereinement le présent.
Le “pieux” mensonge au nom de la “Vérité vraie” et les lubies d’ignorants inventant des entités menaçantes exterminatrices sont dites “fadaises” dans le midi de la France et ici : parau ha’avare, parau punu.
Les déballeurs d’énormités sont présents aussi bien dans le groupe des non-originaires du fenua que dans celui des originaires plus ou moins métissés, se revendiquant mā’ohi depuis les années 1980. Parfois, c’est comme s’il existait un concours. À friser le ridicule ! Ridicule qui ne tue pas les corps, mais participe à geler, tuer la pensée. Or geler, tuer la pensée, c’est amener le plus grand nombre à laisser à autrui le soin de penser et décider à sa place. Œuvrer à empêcher le développement de la pensée critique participe à générer les dérives de comportement d’une partie de notre jeunesse. Les adeptes de la délégation de leur pensée entre les mains d’autrui sont facilement sous emprise et excellent à débiter des phrases toutes faites. Mobiliser à nouveau leurs impertinentes cellules grises endormies, c’est faire acte de culture et d’amitié.
Les originaires et non-originaires du fenua se racontent des films plutôt différents dans un même paysage. C’est normal car les uns et les autres n’ont pas vécu l’Histoire de la même façon. Ils n’étaient pas et ne sont toujours pas forcément du même côté des fronts de batailles. Il y eut des vainqueurs et des vaincus. La ligne de démarcation persiste invisible dans des combats d’apparence pacifique pour la maîtrise des rivages et de l’espace. Autant être lucide. Par exemple, les SDF ne se recrutent que dans une seule ethnie. Signe non pas d’infériorité congénitale, mais d’une mise à l’écart systémique qui exige une réflexion suivie d’actes salutaires.
Attardons-nous sur ce qu’une majorité des originaires du fenua présente comme son ossature, son identité profonde. Attardons-nous sur la religion, dont beaucoup se drapent. Sur les faits de l’Histoire, sans pudeur aucune, ça ment comme pas possible.
Ainsi le 5 mars 1797 est célébré comme la date de l’arrivée de l’Évangile en ce qui est aujourd’hui la Polynésie française. Or, c’est faux.
Le premier office chrétien célébré dans nos îles le fut en juillet 1595. Mendana assista à cette messe avec son épouse et nomma ces îles : “Marquises”.
Le deuxième office le fut à Tahiti en 1772 à la Presqu’île, par des Espagnols qui y restèrent évangéliser jusqu’en 1776. En vain. Les habitants étaient très heureux de leur mode de vie. Ils n’éprouvaient nul besoin d’en changer.
Le Duff affrété par la London Missionary Society arriva le 4 mars 1797 dans l’indifférence générale. Et non le 5 mars dans la liesse comme d’aucuns tentent de le faire croire. Ce n’est que vingt ans plus tard, dans les années 1817-18, que les Tahitiens en deuil permanent depuis l’introduction de maladies épidémiques par Wallis en 1767 et renouvelées par tous les navires suivants, commencèrent à s’intéresser aux discours des hommes pâles. L’attrait devint impérieux quand ils commencèrent à avoir faim. Car John Orsmond en rajouta à la détresse en faisant abattre nombre d’arbres à pain. Il provoqua et organisa la faim en créant la pénurie alimentaire d’aliments traditionnels. C’était le seul moyen qu’il avait trouvé pour attirer les Tahitiens et leur fournir l’Évangile, en même temps que la farine importée. (Tahiti aux temps anciens, Ed. 2000 p. 12)
Étrange est aussi le silence sur la pudibonderie qui prévalut plus d’un siècle. En témoignent les photographies anciennes où les vêtements partent du cou des femmes jusqu’à leurs chevilles et cachent leurs bras. Où les chemises à manches longues, vestes et pantalons engoncent les hommes. “Cachez ces peaux que l’on ne saurait voir !” fut asséné à ce peuple qui ne se dévêtait pourtant qu’en allant à la mer ou la rivière. Les femmes surtout durent se baigner habillées et garder leurs vêtements mouillés, se rendant ainsi vulnérables aux refroidissement si dangereux au temps de la propagation durant deux cents ans du bacille de la tuberculose.
Les danses furent interdites sous peine de sanctions sévères. Le Protectorat français leva les interdits religieux pesant sur les danses. Réjouis, mais encore honteux de leurs corps religieusement maudits, les insulaires superposèrent sur leurs peaux trop belles pour être exposées aux regards, les vêtements du dimanche et, par dessus, des souvenirs des costumes de danses ancestrales. Ils devaient drôlement souffrir sous ces accoutrements. Et il en fallut des décennies avant qu’ils ne s’en allègent !
Ce 5 mars 2021, des jeunes gens presque nus dansèrent gracieusement un 5 mars 1797 qui n’a jamais eu lieu. Si leurs ancêtres avaient dansé ainsi, les missionnaires se seraient cachés ou, se voilant la face tout en zieutant entre leurs doigts, ils auraient brandi leurs Bibles en les traitants d’enfants de Satan, Tamari’i ’a Tatane. C’est d’ailleurs ainsi que ma grand-mère me grondait quand je dansais au rythme des pahu et tō’ere lointains.
Pourquoi les responsables politico-religieux continuent-ils de mentir ? La mauvaise date est même devenue jour férié ! C’est du grand n’importe quoi !
Une élue indépendantiste réclame le retour du contenu des archives polynésiennes conservées en Europe afin de se réapproprier son Histoire. C’est une excellente idée. Mais quand on voit le traitement infligé aux faits avérés, on se demande pourquoi ! Est-ce pour mieux les dissimuler comme des “secrets-défense” ? Notons que dans le domaine dit de la Culture, on ne met presque jamais des gens compétents. Il n’y a jamais d’exigence de formation aboutie correspondant aux missions confiées. Au service des archives, je n’ai jamais connu d’archiviste dûment formé. Oh des gens y travaillent, certes. Et avec application. Mais sans la formation adéquate. Des personnels s’en plaignent. C’est comme si, dans ce domaine, il semble y avoir un consensus pour se contenter de l’à-peu-près. Affichant parfois une bizarre fierté d’y avoir placé des personnels formés à autre chose. Il est vrai que nos gouvernants sont rarement de vrais experts en quelque chose. Beaucoup ont commencé un cursus universitaire, mais se sont arrêté en cours de route. Ce sont des “presque” experts qui se cooptent mutuellement. Comme si l’on redoutait de nommer des personnels sérieusement formés. Je me demande ce qu’en diront les générations futures quand viendra leur temps. Surtout si elles sont plus exigeantes envers elles-mêmes.
Par contre, là où il y a du personnel nationalement et donc internationalement reconnu compétent, j’ai vu des audits se succéder de manière ahurissante. Pour en définitive mettre à leur tête des incompétents notoires. Comme pour brimer la vraie compétence et la punir.
Quant à l’Académie, nul n’a jamais éprouvé la nécessité d’y faire un audit sérieux. Pourtant, la lecture du dico en signale l’urgence gravissime.
À croire que l’incompétence et le contre-emploi rassurent nos élites politico-religieuses.
Certains de nos non-originaires du fenua ont eux aussi des comportements singuliers. J’en connais qui, présents depuis près de cinquante ans, s’estiment être toujours des “invités” et, par exemple, n’achètent pas de terre pour ne pas participer à la flambée du prix du foncier. Une de mes amies m’a demandé de chercher un mot pour la définir, elle qui est arrivée bébé : “Aux Antilles, il y a les Békés. Je suis Popa’ā. Mais je n’ai rien à voir avec la Popa’ā qui débarque et se croit tout permis. Il n’y a pas de mot pour dire qui je suis.” Elle en était profondément chagrinée.
D’autres se revendiquent Tahitiens avant même de poser le pied à Faa’a ou d’ancrer leur bateau dans le lagon. Leur rappeler même gentiment qu’ils ne le sont pas est vécu comme une agression raciste. Bizarre ! Déconcertant. Car jamais en Afrique noire ou du Nord, un Métropolitain ne s’est revendiqué Sénégalais ou Algérien. En Indochine, nul ne s’est revendiqué Nha qué. En Nouvelle-Calédonie, nul ne se prétend Kanak s’il ne l’est pas pas et à Wallis-et-Futuna idem. Mais ici ! C’est spécial.
Ainsi, sommes-nous dans notre diversité chatoyante, parfois parfumée et parfois malodorante.
Puissions-nous privilégier les doux parfums. Seule la connaissance approfondie de nos passés respectifs nous aidera à vivre plus sereinement le présent.

 Edito
Edito