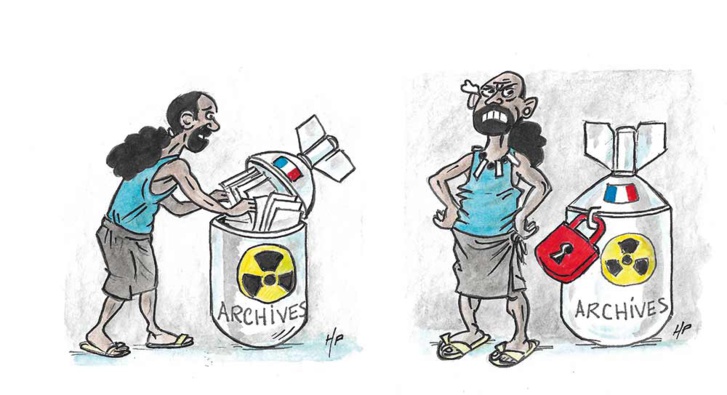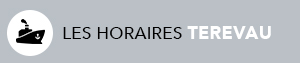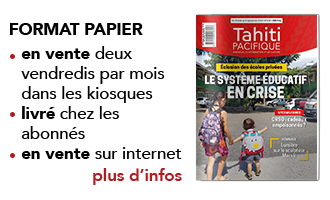Les récentes études réalisées par l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) sont alarmantes : on ne parlera plus tahitien d’ici une cinquantaine d’années. “Si on ne fait rien, dans une génération nous aurons affaire à une langue morte”, alerte même le linguiste Jacques Vernaudon. Les langues polynésiennes, et en particulier le reo tahiti, sont en danger ; c’est pourquoi il est urgent d’agir pour sauver ces formidables vecteurs d’expression de la pensée, qui sont autant d’instruments magiques pour apprivoiser le monde et se libérer. Dès son arrivée au fenua, en 1801, John Davies, considéré par certains comme le père de la linguistique polynésienne, est fasciné : “La langue tahitienne possède une beauté et une énergie dont les Européens n’ont aucune conscience”. Pourtant, à partir de l’Annexion en 1880, toutes les entités publiques et religieuses sont tenues d’enseigner le français et d’interdire l’usage du tahitien. Ainsi, durant un siècle, les Polynésiens sont victimes d’une politique d’assimilation intensifiée dans les années 1960, où l’hégémonie de la langue de Molière est affirmée et la stigmatisation du reo tahiti, systématique. En classe, les enfants qui “osent” s’exprimer dans leur langue maternelle sont même brimés et punis… jusqu’à être obligés à porter un bonnet d’âne !
De cette époque, John Doom, grand défenseur du reo tahiti, racontait : “Un triste procédé m’a beaucoup marqué au cours de ma scolarité à Mataiea. Presque tous les jours d’école, c’est moi qui avais le symbole, une petite pierre qu’un camarade te remettait lorsqu’il t’entendait parler tahitien, car cela était interdit. À la fin de la journée, celui qui avait le symbole, avait le choix : soit écrire cinq cents fois « Je ne dois pas parler tahitien à l’école » ou alors arracher cinq cents pieds de sensitive dans la cocoteraie proche de l’école. Certains d’entre nous devinrent experts pour attacher ensemble cinq crayons à papier avec le bon écartement pour correspondre aux lignes du cahier, ce qui fait qu’en une fois on pouvait écrire cinq lignes !” Aujourd’hui, quelle est la place des langues polynésiennes dans notre société ? Comment les faire survivre et leur donner un second souffle après avoir interdit leur pratique ?
Les nouvelles applications sur smartphones, les dictionnaires en ligne, ou encore l’apprentissage 2.0 via des plateformes sur la Toile facilitent désormais l’accès aux langues, mais il convient d’aller plus loin. Le Pays l’a enfin compris en créant depuis 2019 des écoles bilingues français-tahitien à parité horaire. Ce dispositif devrait être renforcé à la prochaine rentrée scolaire, puis être, étendu, à terme, à l’ensemble des archipels. Marc Maamaatuaiahutapu dit Maco Tevane, ancien président de l’Académie tahitienne et ministre de la Culture, considérait : “La langue, ne l’oublions pas, est un des chaînons qui nous relie à notre passé et à nos origines, c’est un patrimoine que nous ont légué nos ancêtres et que nous devons préserver pour qu’à notre tour, nous le léguions à nos enfants. Elle est un rempart contre la banalité de la culture uniformisante qui nous envahit de plus en plus, et de jour en jour.” Famille, École, société civile : c’est donc l’affaire de tous. Pour reprendre la délicieuse formule de notre chère Simone Grand, chroniqueuse bien connue des lecteurs de TPM : “Redonnons du sens aux mots ! Le reo tahiti doit être comme un bonbon qui se savoure…”.
Ensemble, faisons bouger les lignes !
Bonne lecture, te aroha ia rahi.
De cette époque, John Doom, grand défenseur du reo tahiti, racontait : “Un triste procédé m’a beaucoup marqué au cours de ma scolarité à Mataiea. Presque tous les jours d’école, c’est moi qui avais le symbole, une petite pierre qu’un camarade te remettait lorsqu’il t’entendait parler tahitien, car cela était interdit. À la fin de la journée, celui qui avait le symbole, avait le choix : soit écrire cinq cents fois « Je ne dois pas parler tahitien à l’école » ou alors arracher cinq cents pieds de sensitive dans la cocoteraie proche de l’école. Certains d’entre nous devinrent experts pour attacher ensemble cinq crayons à papier avec le bon écartement pour correspondre aux lignes du cahier, ce qui fait qu’en une fois on pouvait écrire cinq lignes !” Aujourd’hui, quelle est la place des langues polynésiennes dans notre société ? Comment les faire survivre et leur donner un second souffle après avoir interdit leur pratique ?
Les nouvelles applications sur smartphones, les dictionnaires en ligne, ou encore l’apprentissage 2.0 via des plateformes sur la Toile facilitent désormais l’accès aux langues, mais il convient d’aller plus loin. Le Pays l’a enfin compris en créant depuis 2019 des écoles bilingues français-tahitien à parité horaire. Ce dispositif devrait être renforcé à la prochaine rentrée scolaire, puis être, étendu, à terme, à l’ensemble des archipels. Marc Maamaatuaiahutapu dit Maco Tevane, ancien président de l’Académie tahitienne et ministre de la Culture, considérait : “La langue, ne l’oublions pas, est un des chaînons qui nous relie à notre passé et à nos origines, c’est un patrimoine que nous ont légué nos ancêtres et que nous devons préserver pour qu’à notre tour, nous le léguions à nos enfants. Elle est un rempart contre la banalité de la culture uniformisante qui nous envahit de plus en plus, et de jour en jour.” Famille, École, société civile : c’est donc l’affaire de tous. Pour reprendre la délicieuse formule de notre chère Simone Grand, chroniqueuse bien connue des lecteurs de TPM : “Redonnons du sens aux mots ! Le reo tahiti doit être comme un bonbon qui se savoure…”.
Ensemble, faisons bouger les lignes !
Bonne lecture, te aroha ia rahi.

 Edito
Edito